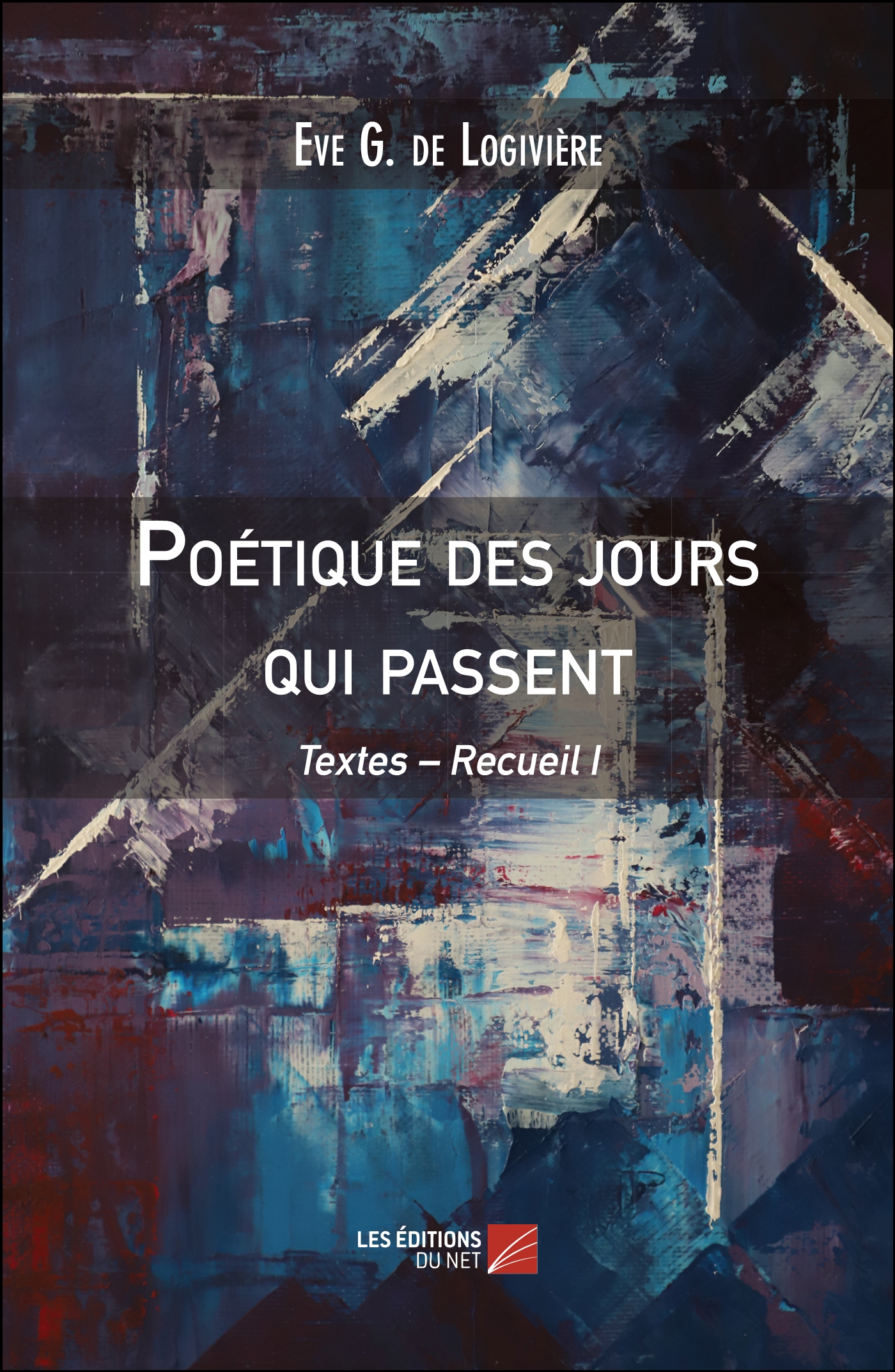
Poétique des jours qui passent - Textes – Recueil I
Comment traduire le singulier qui s’inscrit au fil des jours à l’ombre de carnets personnels ?
Comment laisser vivre ces respirations tel un cycle de lunaison dont chaque parcours est unique, toujours le même dans son rythme, et pourtant toujours différent ?
Comment se faire l’écho de parcelles d’éprouvés des femmes et des hommes déposant en thérapie, un entre deux de vie ?
Le poétique, peut-être, nous donne l’opportunité de s’en saisir pour l’écrire, et y trouver un reflet dans la rencontre de textes d’auteurs ; formant ainsi un tissage pour habiter la vie, la traverser, et devenir créateurs des mouvements du vivant en soi.
Psychothérapeute, psychanalyste et enseignante de yoga, j’exerce et vis à Angers.
De mon travail d’écoute depuis plus de 24 ans maintenant, s’est traduit sur des carnets, l’écho poétique des traces posées dans l’espace de l’intime ; les histoires singulières de celles et ceux venus me rencontrer, résonnent et s’entrechoquent avec ma propre histoire et avec notre monde.
Dès l’aube de mon enfance, l’écriture m’accompagne. Et aujourd’hui au seuil d’une autre moment de ma vie, je souhaite partager ces mots dressés sur le papier, comme une invite aux mouvements de vie.
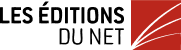





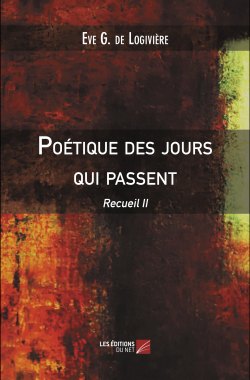
Les mots, l'art, un mariage d'émotions profondes transmises dans ce recueil intime. A lire et relire en attendant le n°2
Signalement
beaucoup d'émotions à la lecture de ce recueil. expression subtile de la rencontre avec l'Autre, l'Autre en face de Soi, l'Autre en Soi. Merci
Signalement
Un recueil plein d'émotions, un témoignage qu'il est possible d'aller de l'ombre vers la Lumière,
Un grand merci pour ce partage !
Et Merci à vous Éditeur de permettre aux Créateurs de s'exprimer
Signalement
Dans Poétique des jours qui passent, Recueil I, Eve G. De Logivière propose une œuvre rare, où la poésie devient expérience de transformation.
Le texte inaugural, De l’analyse, ne se contente pas d’introduire le recueil : il en déploie la matrice, le mouvement respiratoire et la portée éthique.
Ce poème se lit comme un rite de passage, à la fois personnel et universel, entre le silence et la parole, la contraction et l’ouverture, la faille et la lumière.
Il traduit dans la langue du poème ce que la psychanalyse, le soin ou la présence humaine peuvent offrir : un espace de lente traversée vers la vie retrouvée.
Le poème comme séance
Voyage singulier / à deux / dans cette impérative / nécessité / d’un écho / d’un regard / d’un point à l’horizon.
Ces premiers vers installent le cadre symbolique : le poème est une séance, un chemin à deux voix.
L'autrice y inscrit la présence de l’autre — celle du thérapeute, du lecteur, de l’ami, du double intérieur — comme condition du mouvement.
L’analyse devient une cordée humaine, tendue entre deux solitudes reliées par la parole.
Le tutoiement n’est jamais explicite, mais l’adresse affleure.
L’autre est là, non pour sauver, mais pour témoigner du passage, maintenir le fil du souffle.
C’est une poésie de la relation : sans l’écho, pas de déploiement possible.
Les verbes de la métamorphose
Se poser / Se recroqueviller / Se déplier / Se redresser.
Cette suite de verbes compose une chorégraphie intérieure.
Ils ne décrivent pas un état mais une cinétique du sujet : le mouvement même de l’existence psychique.
Chaque verbe est une posture du corps et de l’âme ; ensemble, ils forment une grammaire de la reconstruction.
Cette simplicité syntaxique n’a rien de naïf : elle traduit une pensée du vivant, une écoute du rythme organique du soin.
La syntaxe respire.
Les mots s’espacent pour laisser place à ce que le psychanalyste Bion appelait le temps intérieur du penser : ce temps de gestation où la pensée se fait sensation avant de devenir mot.
Descendre en cordée : l’analyse comme exploration du dedans
Descendre / en cordée / au rythme / du temps intérieur / Remonter à la source / de l’abîme.
La métaphore de la montagne et de la descente est l’une des plus puissantes du texte.
Elle évoque le travail analytique : aller vers le fond sans s’y perdre, s’arrimer à la relation pour ne pas chuter dans le silence absolu.
La « cordée » figure la dimension éthique du lien : la parole ne se pratique jamais seul.
Mais le plus frappant est le retournement : remonter à la source de l’abîme.
L’abîme, loin d’être négatif, devient source.
Ce renversement est au cœur de la poétique d’Eve G. De Logivière : il n’y a pas d’ombre qui ne contienne une semence de lumière.
La descente est passage, non enfermement.
Nommer l’indicible : le langage en travail
Nommer / là où il n’y a pas de mots / Se saisir / de la contrainte au silence / pour en dire l’indicible.
Le poème rejoint ici les enjeux les plus profonds de la psychanalyse et de la poésie moderne :
comment dire ce qui ne peut se dire ?
comment parler depuis la zone où la langue se défait ?
Eve G. De Logivière transforme cette question en acte poétique.
Elle ne cherche pas à résoudre la contradiction : elle la fait respirer.
Les mots s’arrêtent au bord de l’inexprimable, mais continuent d’ouvrir.
C’est une écriture qui accueille le silence plutôt qu’elle ne le comble.
Ainsi, De l’analyse devient le manifeste d’une poétique de la retenue :
une parole qui ne dit pas tout, mais laisse advenir le sensible.
La lumière retrouvée : du dedans vers l’aube
Se saisir / de la lumière de l’aube / d’un advenir / Se saisir / de la force du vivant / dans la foi d’un devenir.
La seconde partie du poème passe du mouvement de descente à celui de la remontée.
Après la nuit intérieure, l’aube se lève : c’est la renaissance, l’ouverture du regard.
La lumière n’est pas transcendante ; elle émane du travail même de la parole.
Elle surgit du fait d’avoir traversé la faille, d’avoir nommé ce qui était muet.
On entend ici une dimension spirituelle, non religieuse :
la foi n’est pas croyance, mais confiance dans le processus du vivant.
La psychanalyse et la poésie se rejoignent dans cette confiance :
accepter que quelque chose, toujours, se recrée après la déchirure.
L’injonction vitale : Part ! Coure ! Danse !
Après l’introspection, le corps réapparaît ; la parole devient geste, énergie.
Cette triple injonction n’est pas seulement une sortie de la douleur : c’est un retour au monde.
Le souffle, mot-clé du poème, se métamorphose en souffle de vie.
Le corps n’est plus le lieu de la blessure, mais celui de la présence.
C’est tout le parcours du recueil : passer de la contemplation de la fragilité à la célébration du mouvement.
Le poétique devient non plus refuge, mais moteur.
Le vers final : une éthique du poétique
Il n’y aurait / que le poétique / pour le dire.
Le poème se referme sur ce constat apaisé, presque chuchoté.
Le poétique n’est pas ici un ornement de la pensée, mais la seule voie d’accès au vrai.
Ce que la parole analytique explore, le poétique le fait exister.
L’un et l’autre partagent la même humilité : ils ne prétendent pas expliquer, ils cherchent à accueillir.
Le poétique est ainsi défini comme langage du lien : entre soi et soi, entre soi et l’autre, entre le visible et l’invisible.
Il ne guérit pas ; il met en circulation ce qui, sans lui, resterait figé.
Un recueil comme atelier du sensible
Dans l’économie de Poétique des jours qui passent, ce texte joue le rôle d’un prologue.
Les poèmes suivants prolongent cette écoute : ils déclinent l’attention, la mémoire, la trace, la rencontre.
Mais tout commence ici : dans cette descente puis remontée, dans cette reconquête du souffle.
La poésie d’Eve G. De Logivière se situe à la croisée de plusieurs traditions :
celle du lyrisme intérieur (à la Rilke, à la Guillevic),
celle de la psychanalyse existentielle (Ferenczi, Winnicott, Bion),
et celle d’une spiritualité du quotidien, humble et sensorielle.
Elle écrit à partir du fragile, et fait de ce fragile un lieu d’appui.
Chaque poème est une clairière ouverte dans la densité du vécu.
C’est une œuvre du murmure, de la lumière basse, de la fidélité au souffle.
Conclusion
De l’analyse est bien plus qu’un poème : c’est une expérience du langage à l’état naissant.
Il s’y joue l’avènement du sujet à travers le mot, le silence, la respiration.
De cette traversée surgit une certitude douce :
ce n’est pas la parole qui sauve, mais la manière de l’habiter.
À l’instar d’une séance où le patient se découvre en parlant,
Eve G. De Logivière se découvre en écrivant,
et nous offre la possibilité de nous reconnaître dans ce mouvement.
Il n’y aurait, en effet,
que le poétique
pour le dire.
Signalement